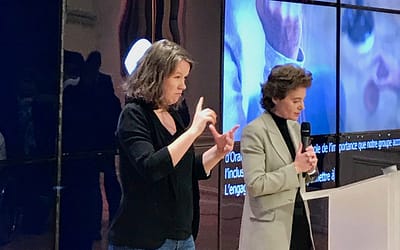L’interprète qui œuvre auprès de comités de groupe européens découvre rapidement que certains questionnements sont universels. La notion de transnationalité, notamment, est au CEE ce que la question « qu’est-ce qu’on mange ?» est au foyer : récurrente, inévitable, constitutive.
Dans notre premier chapitre dédié au comité européen, nous rappelions qu’il a pour objectif d’assurer l’information et la consultation des travailleurs sur des questions transnationales. Cependant, la définition de cette transnationalité peut donner lieu à des interprétations divergentes.
Comment définir qu’une décision est importante ?
Pour rappel, l’article 1(4) de la directive 2009/38/CE stipule que le caractère transnational d’une question se détermine « en prenant en compte l’étendue de ses effets potentiels ainsi que le niveau de direction et de représentation qu’elle implique ». Elle précise que la transnationalité couvre les questions qui « concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe ou au moins deux établissements ou entreprises situés dans des États membres différents ».
Toutefois, la directive va plus loin en affirmant que des questions peuvent aussi être transnationales si elles revêtent « de l’importance pour les travailleurs européens, même si elles n’affectent qu’un seul pays directement ». Ce dernier élément laisse place à l’interprétation : les partenaires sociaux peuvent en adopter une lecture large ou, au contraire, restrictive. A partir de quand un impact devient-il important ? Se détermine-t-il, par exemple, selon le nombre de postes touchés dans le cadre d’une réorganisation ?
Le définir clairement au sein d’un accord interne pourrait sembler utile, mais cela revient en réalité à se tirer une balle dans le pied : pour les représentants du personnel, fixer un seuil de 30 postes supprimés implique qu’à 29, on ne consulte pas. Pour la direction, cela veut dire qu’on ne peut plus communiquer que le plan n’est pas significatif s’il dépasse ce seuil, même si l’entreprise compte plusieurs dizaines de milliers d’employés.
Au-delà du nombre apparaît aussi la question du temps. Une décision peut impliquer des petits changements qui, après plusieurs années, déboucheront sur des conséquences importantes. Se concentrer sur une période plus ou moins longue peut donc sensiblement changer l’importance perçue d’une décision.
L’interprétation large : le souci du détail
Pour les partisans d’une interprétation large, la transnationalité doit s’envisager selon une perspective longue et globale :
- Portée étendue des effets. Une décision peut avoir un impact indirect sur plusieurs pays, même si elle semble localisée à court terme. Fermer une filiale en Allemagne en 2015 peut impliquer un report de charge sur des lignes au Portugal en 2016.
- Tendances et effet d’entraînement. Une réorganisation ou un changement social dans un seul pays peuvent refléter une stratégie d’ensemble à bas bruit et se répéter l’année suivante dans un autre. Il peut aussi s’agir d’un projet pilote destiné à être généralisé à long terme.
- Vision européenne du dialogue social. L’harmonisation progressive des conditions de travail et la coopération entre les représentants des différents pays justifient la consultation du CEE. Par exemple, la prime dite « Macron » versée aux seuls salariés français a pu avoir du mal à passer auprès des autres.
Ainsi, selon cette approche, toute mesure importante dans un État membre pourrait potentiellement relever du CEE. Certains avancent même qu’il suffit que le siège se trouve dans un autre pays que la filiale touchée pour que la décision s’avère transnationale. Une interprétation abusive aux yeux des tenants d’une interprétation plus restrictive.
L’interprétation restrictive : la primauté des instances nationales
D’autres acteurs adoptent en effet une lecture plus limitative de la directive. Cette approche s’appuie sur plusieurs arguments :
- Impact localisé à court terme. Une question ne devrait être transnationale que si elle affecte à court terme au moins deux pays. Après tout, comment être certain des conséquences d’une décision prise pour une filiale polonaise en 2025 sur une usine italienne en 2027 ?
- Indépendance des filiales. Chaque pays dispose de son propre droit du travail et de ses propres instances représentatives. Il appartient donc à celles-ci de traiter les sujets à portée nationale. Le COVID a fait l’objet de nombre d’informations, mais les consultations étaient souvent inapplicables : chaque filiale était tenue de mettre en place des mesures nationales parfois incompatibles avec celles de ses voisins (règles de chômage partiel, fermetures…).
- Protection des prérogatives nationales. Accepter une interprétation large revient à européaniser des sujets qui relèvent du dialogue social national. C’est notoire dans l’organisation d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, dont la consultation n’est que de 30 jours en Espagne. Ce délai est difficilement conciliable avec l’organisation d’une information/consultation avec un CEE. Le respect des délais de consultation de l’instance peut même nuire à son image. Les représentants nationaux peuvent percevoir l’instance comme un frein à la mise en place de conditions négociées avec leur direction. Le risque d’incompréhension est d’autant plus fort que le Comité Européen ne jouit d’aucun pouvoir de négociation.
Selon cette interprétation, une décision touchant un seul pays ne devrait donc pas relever du CEE, sauf si elle est explicitement conçue dans une stratégie de groupe affectant plusieurs filiales.
Une question de sensibilité à clarifier
L’ambiguïté de la transnationalité est loin d’être anodine. Les tensions qu’elle alimente en viennent même à être tranchées par les juges. La pratique s’avère hétérogène d’une entreprise à l’autre, selon sa culture, son expérience ou ses traditions de dialogue social. C’est notamment sur ces questions qu’une nouvelle réforme de la directive pourrait fluidifier le dialogue au sein des CEE. En attendant, pour ce qui est de fluidifier les débats multilingues, vous pouvez toujours compter sur Pourparlers !